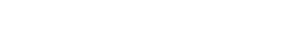La pratique de la protection de la nature doit s’appuyer sur la conviction de ce qui est juste d’un point de vue éthique et d’un point de vue esthétique, mais aussi ce qui est utile d’un point de vue économique. Une chose est juste uniquement si elle sert à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté, une communauté dont font partie le sol, les eaux, la faune, la flore mais aussi les hommes.
Il ne peut être juste, au sens écologique du terme : qu’un agriculteur draine le dernier marais, fasse pâturer les dernières forêts ou sacrifie le dernier bosquet de sa communauté, parce que, ce faisant, il détruit la faune, la flore, et un paysage dont l’appartenance à la communauté est plus ancienne que la sienne, et mérite le respect autant que lui.
Il ne peut être juste, au sens écologique du terme, qu’un agriculteur canalise ses torrents et fassent pâturer ses pentes raides, parce que, ce faisant, il provoque des problèmes d’inondation chez ses voisins en aval, de la même manière que ses voisins en amont en ont provoqué chez lui. En ville, nous ne nous débarrassons pas des choses qui nous dérangent en les jetant par-dessus la clôture des voisins, mais nous continuons à le faire dans notre gestion des eaux.
Il ne peut être juste, au sens écologique du terme, qu’un chasseur de cerfs détruise la forêt pour continuer à pratiquer son sport, ni qu’un chasseur d’oiseaux massacre les faucons et les chouettes pour pouvoir continuer à pratiquer le sien, ou qu’un pêcheur massacre les hérons, les martins-pêcheurs, les sternes et les loutres pour pouvoir continuer à pêcher. Ces méthodes cherchent à mettre en pratique une forme de protection de la nature en en détruisant une autre, et elles bouleversent ainsi l’intégrité et la stabilité de la communauté.
Si nous admettons qu’une conscience écologique est possible et nécessaire, son premier principe doit être celui-ci : les arguments économiques ne suffisent plus à excuser des usages de la terre qui nuisent à la société (ou, pour employer des mots plus forts, des crimes écologiques). Mais il s’agit d’un constat négatif, et je préférerais employer une formule positive, en affirmant qu’un bon usage de la terre devrait être récompensé par la société proportionnellement à son importance sociale.
Je ne me fais pas d’illusion sur la rapidité avec laquelle une conscience écologique peut porter ses fruits. Il a fallu dix-neuf siècles pour définir un code éthique à même de régir la conduite des hommes entre eux, et rien n’est encore parfait. L’élaboration d’un code de conduite portant sur les relations entre l’homme et la terre pourrait bien prendre autant de temps. Nous ne devrions pas trop nous inquiéter, si ce n’est de la direction que nous suivons. Cette direction est claire et nous devons commencer par fixer les normes de ce qui est juste et injuste dans l’usage de la terre. Il ne faut plus être intimidé par l’argument selon lequel une action juste est impossible parce qu’elle n’assure pas un maximum de profits, ou qu’une action injuste doit être pardonnée parce qu’elle rapporte de l’argent. Cette philosophie n’a plus cours dans les relations humaines, et il est grand temps que nous l’abandonnions en ce qui concerne les relations de l’homme à la terre.
Aldo Leopold
Texte extrait de l’ouvrage « La Terre comme communauté », éditions Wildproject 2021, qui est une anthologie de textes d’Aldo Leopold (1887-1948)