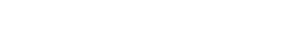En 1934, Jean Giono explique la guerre par « cet esprit d’esclavage qui se transmettait de génération en génération, ces mères perpétuellement enceintes d’enfants conçus après le travail qui n’avaient mis au monde que des hommes portant déjà la marque de l’obéissance morale ». Il se reprochait de n’avoir pas eu le courage de déserter pendant la Grande Guerre, et en déduisait un seul impératif éthique : refuser d’obéir. Toutes les grandes catastrophes du XXème siècle furent, en effet, des désastres de l’obéissance, de l’incapacité totale de chacun à résister à l’autorité quelle qu’elle soit – y compris chez les militants de partis dits révolutionnaires -, et c’est pourquoi elle impose un questionnement à la fois anthropologique et historique sur l’origine de cette servilité : « Quel mal encontre a esté cela, qui a peu tant dénaturer l’homme, seul né de vrai pour vivre franchement ; et lui faire perdre la souvenance de son premier estre et le désir de le reprendre », demandait La Boétie, le premier à penser l’Histoire comme dénaturation par domestication, avènement de la servitude et destin de la servilité.
Il importe donc de ne pas être dupe de l’interprétation idéologique du rapport à l’idéologie : c’est toujours le conformisme et non le fanatisme qui garantit la soumission à l’idéologie dominante ; mais il la garantit efficacement. Le fanatique n’est jamais que le cas limite mis en exergue par la propagande, parce que, comme le disait Nietzsche, « la pose grandiose de ces esprits malades, de ces épileptiques du concept, agit sur la grande masse ». Au sein de l’armée, le consentement à la guerre, l’acceptation du sacrifice au nom de la patrie, est le fait d’une minorité de dominants, les gradés, soit environ 10 % des effectifs, qui imposent alors leurs discours et leur interprétation des événements à l’ensemble de la société : une minorité de fanatiques a consenti à la guerre, une minorité de rebelles, plus minoritaire encore, l’a refusée, l’écrasante majorité des soldats l’a endurée.
C’est donc un contresens que d’expliquer la Première Guerre mondiale par le retour d’une sauvagerie refoulée, c’est-à-dire par un relâchement ou une suspension des principes de la civilisation, dont elle montre au contraire que la barbarie est un produit spécifique. Maurice Drans, soldat français, écrit en 1916 de Verdun à sa femme : « Les camarades font leur instruction destructrice. Demain ils tueront. Tuez ! Telle est la devise… Ainsi la civilisation raffine et développe la barbarie. » Barbarie instruite, méticuleuse et disciplinée ; bien loin de la horde sauvage de tueurs, les combattants de 1914-1918 ressemblaient bien plutôt à « une bande de gens apeurés qui se lance en avant en fermant les yeux et en serrant leurs armes contre leur poitrine » (M.Morel-Journel, Journal d’un officier de la 74ème division d’infanterie), un régiment qui n’était plus que ce « tas d’habitudes mélancoliques , un troupeau d’hommes jetés ensemble » et occupés à « la même routine de fonctionnaires abrutis et malheureux », tel que le décrit Maurice Genevois. La Grande Guerre n’a pas annulé les principes de la morale, elle les a menés à leur terme. « Tant d’horreurs n’auraient pas été possibles sans tant de vertus. Il a fallu, sans doute, beaucoup de science pour tuer tant d’hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant de villes en si peu de temps ; mais il a fallu non moins de qualités morales. Savoir et Devoir, vous êtes donc suspects », écrivait Paul Valéry dès 1919 avec son indéfectible lucidité : la Grande Guerre s’est d’abord avant tout fondée sur la morale du devoir, dont elle a révélé le potentiel d’anéantissement. Elle fut en cela la guerre idéologique par excellence, justement parce qu’elle a dissous toutes les idéologies particulières pour la seule idéologie du devoir, sacrifice à l’Universel dont elle a ainsi révélé la négativité, elle a montré le nihilisme inhérent à la hiérarchie. C’est finalement un soldat français, Rodolphe Fillaud qui, en décembre 1917, a le mieux formulé la leçon philosophique qu’il convient de tirer de la Grande Guerre : « J’étais patriote mais avec la bande de cochons que nous avons à nous gouverner on devient tout à fait anarchiste ».
Jean Vioulac
Extrait de l’ouvrage « Métaphysique de l’Anthropocène – Nihilisme et totalitarisme », éditions PUF 2023, pp. 213-215