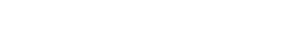L’articulation entre autonomie et abondance pose un problème particulièrement vif si on l’analyse du point de vue des asymétries géographiques et politiques du XIXème siècle – c’est-à-dire si l’on prend acte de leur importance dans la construction du régime écologique moderne. Quelle relation peut-on établir entre le succès du paradigme libéral au XIXème siècle et la structure géo-écologique des échanges commerciaux ? Plus précisément : comment un système de valeurs et de représentations politiques né dans le contexte d’une économie organique, encore marginalement intégrée à un marché et à une division du travail mondialisés, a-t-il pu perdurer sans modifications majeures dans un contexte matériel et politique totalement différent ?
Les libéraux du XIXème siècle, qui théorisent et promeuvent la modernité commerçante et industrielle, insistent en effet en grande majorité sur le caractère endogène et auto-entretenu de l’inventivité technoscientifique, de la qualité des institutions, en particulier le droit de propriété, des gains de productivité par la division du travail, de l’esprit d’économie et de sacrifice. Les facteurs de développement seraient donc les mêmes qu’au XVIIIème siècle, et l’émergence progressive d’une économie-monde et d’une industrie de masse n’aurait pas affecté les conditions de réalisation de la liberté individuelle et collective, pas plus qu’ils n’impliqueraient une dette – morale et matérielle – à l’égard des « périphéries ». L’éthique individualiste des premiers libéraux, qui devait contenir en germe à la fois l’amélioration du sort matériel de la population et son accession à un degré de civilité supérieur, a ainsi été transportée dans un nouveau monde, à l’égard duquel elle était largement désajustée.
L’hypothèse qu’il faut faire est donc la suivante : si la signification libérale de la liberté a pu se maintenir comme la forme dominante du projet politique moderne au XIXème siècle parmi les élites intellectuelles et économiques européennes, c’est parce que les asymétries géo-écologiques globales, parallèlement aux nouvelles conditions de production, n’ont pas été prises en compte. Il y a bien un écart entre les idées et les pratiques, que l’on peut rapporter à un désajustement temporel, mais aussi à un désajustement spatial : tout ce qui se déroule loin des centres économiques et intellectuels européens est en quelque sorte hors de l’horizon perceptif des théoriciens de la modernité, préoccupés par l’élimination des freins institutionnels à l’innovation et à la circulation des marchandises.
Pierre Charbonnier
Extrait de l’ouvrage « Abondance et liberté », 2020, éditions La Découverte, pp.154-155